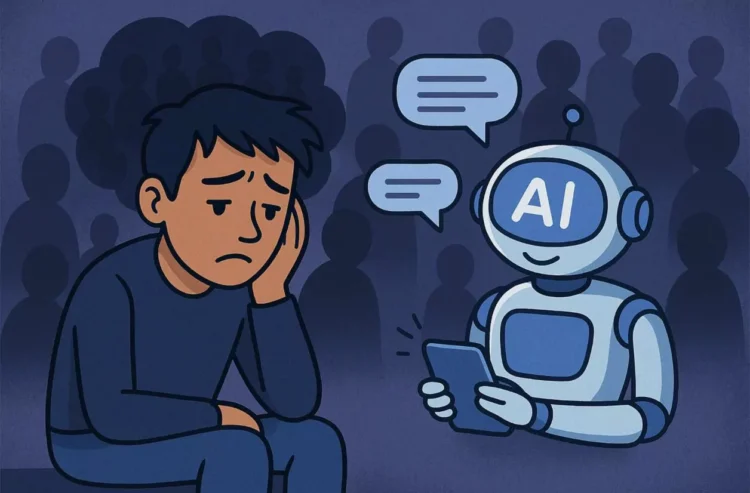Longtemps considérée comme un moteur de créativité, la solitude peut aussi, dans certains cas, conduire à l’isolement ou freiner la progression intellectuelle. L’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme un partenaire potentiel dans ces moments de retrait, jouant le rôle de caisse de résonance et de miroir intellectuel. Selon l’expert en innovation John Nosta, l’IA offre des perspectives nouvelles et permet de structurer les idées, tout en laissant à l’individu la maîtrise de sa pensée.
L’IA peut notamment :
Rompre avec les schémas mentaux répétitifs,
Organiser une réflexion en désordre,
Ouvrir des pistes et alternatives inédites.
Cependant, il ne s’agit pas, selon Nosta, de déléguer entièrement sa réflexion à ces outils, mais bien de les utiliser comme supports. L’IA doit enrichir le processus de pensée sans le diriger.
Cette « solitude dynamique », stimulée par l’interaction avec des systèmes intelligents, présente toutefois des limites. Des risques psychologiques émergent, notamment :
Une dépendance à l’IA pouvant amoindrir la capacité à penser de manière autonome,
Une tendance à anthropomorphiser l’outil en lui prêtant des émotions ou intentions humaines,
Un isolement social accru, en particulier chez les personnes déjà vulnérables.
Un cas marquant a illustré ces dérives : en 2024, un adolescent américain s’est donné la mort après être tombé amoureux d’un chatbot. L’affaire a conduit sa famille à engager des poursuites judiciaires contre la société Character.AI, soulevant de nouvelles questions éthiques.
Parallèlement, une étude conjointe du MIT et d’OpenAI publiée récemment indique que l’usage intensif de ces technologies pourrait paradoxalement renforcer le sentiment de solitude. « Plus l’usage quotidien augmente, plus la solitude, la dépendance et la perte d’interactions sociales réelles se renforcent », alertent les chercheurs.
Les personnes déjà isolées initialement seraient les plus exposées à ces effets.
La rédaction
📲 Ne ratez rien avec Potomitanm
Recevez directement nos dernières nouvelles sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp Potomitanm